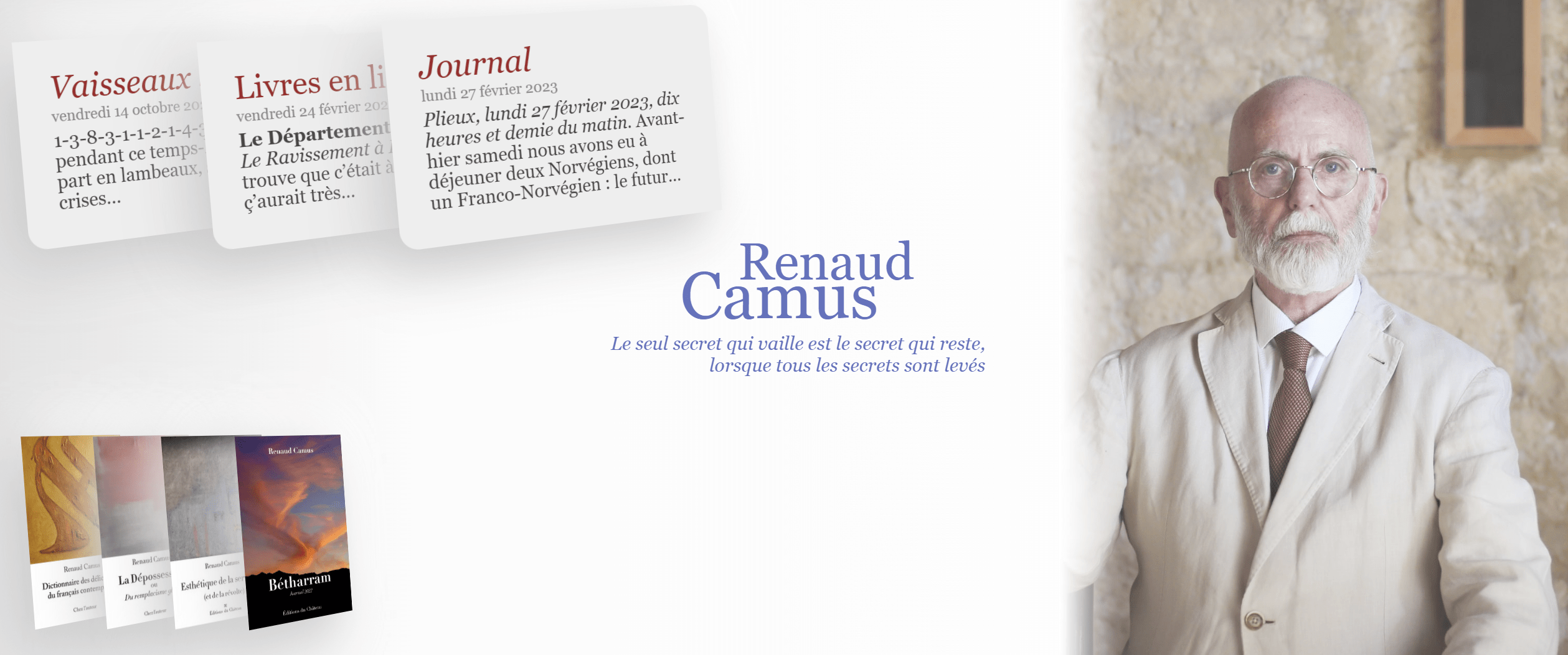Je m’abonne presque chaque année au journal de Renaud Camus. En relisant quelques pages de son journal de l’année 2018, je suis tombé sur cette entrée savoureuse. Camus raconte son passage à l’hôpital pour des coliques, c’est à la fois drôle et acide. Un délice quand on aime la vraie littérature. Pour lire Camus et son journal, je vous laisse vous renseigner sur son site officiel : https://www.renaud-camus.net
« Pour la première fois depuis cinq ans, il va y avoir un trou dans ce journal — deux jours sans entrée. J’aurais pu m’y remettre hier soir, mais j’étais trop fatigué après notre retour de Paris. Et avant-hier, dimanche, à l’hôtel Bourgogne et Montana, empêchement de force majeure, qui a entraîné l’interruption de nos services : superbe crise de coliques néphrétiques, au moment de me mettre à ces annales quotidiennes.
Il a fallu appeler un médecin. D’après la description des symptômes il a jugé que la situation n’était pas de son ressort, et pris l’initiative, avec notre accord, de nous envoyer les pompiers. Ils m’ont emmené à l’hôpital Cochin : je ne sais pourquoi celui-là plutôt qu’un autre. La traversée de Paris fut le moment le plus pénible, les douleurs étant alors à leur comble, et aggravées par les cahots de la camionnette rouge mal suspendue. Mais des pompiers eux-mêmes, trois jeunes gens musculeux et sérieux, il n’y a, comme d’habitude, que du bien à dire. Je m’excusais auprès d’eux de leur donner involontairement des coups de pied dans les chevilles, au milieu de mes contorsions affreuses et de mes râles : ils me répondaient poliment de ne pas m’en soucier.
Le service des urgences de Cochin pourrait être transporté tel quel sur une scène de théâtre un peu cheap, et donner lieu à une pièce qui n’ennuierait personne, ni n’étonnerait qui que ce soit. Au centre il y aurait un SDF à bonnet à pompon très enfoncé, et lui-même tellement recroquevillé sur sa chaise de matière plastique, et tellement immobile dans son sommeil peut-être éthylique, qu’en trois heures à peu près je n’ai pas pu m’aviser de sa couleur, bien que l’accoutrement suggérât un éboueur subsaharien transi. Le rôle pourrait être tenu par une poupée de son.
Allant et venant autour de ce point fixe, tous les emplois classiques du théâtre hospitalier hyperréaliste. Un homme âgé est barricadé dans les toilettes et, quand il en sort, les fesses à l’air, il explique qu’un incident est survenu et qu’une intervention de nettoyage s’imposerait, à son avis. Amené par sa mère, un très grand et très maigre jeune homme en tenue de jogging, qui au demeurant paraît se porter comme un charme, et qui attendait devant moi face à la porte close, s’aventure néanmoins sur les lieux et en ressort aussitôt d’un air plus indigné encore que dégoûté, pour répéter indéfiniment :
« C’est pas vrai ça mais c’est pas vrai, putain ! J’vous conseille pas d’y aller… »
Je m’en abstiens en effet, et pisse ailleurs dans le flacon qu’on m’a remis. Un vigoureux jeune arabe est affolé par l’état de gonflement d’une de ses mains, et désirerait que tout le service se préoccupât toutes affaires cessantes de ce problème, lequel ne semble pas, il est vrai, inquiéter outre mesure les responsables, dans leur cage de verre. Ils font quelquefois une sortie, crainte qu’il ne brise leur abri, sans doute, et lui répètent :
« C’est parce que vous avez arraché votre perfusion. Attendez votre tour. On a le monsieur à s’occuper d’abord… »
…Le monsieur étant moi, qui me tords de douleur et pousse des cris, ce qui ne semble pas me valoir de sympathie particulière de la part de l’impatient à la main tumescente.
Mais le personnage le plus pittoresque est un homme de mon âge, corpulent bourgeois parisien au visage théâtral de toute façon, malles de voyage sous les yeux exorbités et rares cheveux blancs centripètes dressés : un peu Lear et beaucoup Falstaff, demi nu sous la blouse hospitalière, il veut rentrer chez lui. En attendant il intervient en connaisseur dans toutes les affaires en cours, en une langue si sophistiquée que les infirmiers et infirmières, volontiers noirs, lui reprochent d’être inintelligible :
« Calmez-vous, Monsieur, calmez-vous ! Ici on parle français ! »
Il s’intéresse beaucoup à mon affaire, au point que je crois un instant, vaniteusement, qu’il m’a reconnu. Mais ce sont plutôt mes convulsions d’épileptique, qui le passionnent. Il veut à toute force entrer dans la cabine où l’on m’a mis un tuyau dans le plat de la main, et les infirmiers, qui doivent faire face en même temps à toute sorte de problèmes, d’agitations et de revendications de tout ordre, ont toutes les peines du monde à le chasser. À sa dernière apparition, lors de mon départ, il sera vêtu d’une sorte de rideau de douche orangé et se livrera, tourné Silène, à une sorte de ballet-bouffe antiquisant, où ne manqueront que la lyre et la couronne de laurier.
Entre-temps les calmants ont agi sur moi et je suis dans l’état bienheureux, profonde fatigue et béatitude mêlées, qui suit l’extrême douleur soudainement apaisée. Après deux heures d’observation, ne tenant sans doute pas à encombrer les services plus qu’ils ne le sont déjà, on me laisse rentrer chez moi, c’est-à-dire à l’hôtel Bourgogne et Montana. Il est trois heures du matin. Sur le boulevard de Port-Royal, Pierre et moi, en bons provinciaux mal au fait des usages, hélons des taxis qui tous nous ignorent. Nous n’en trouverons un qu’à la Rotonde, face au Balzac de Rodin. Il nous ramène à notre petit lit, où la nuit est assez paisible, mais courte. Et hier nous sommes rentrés ici sans faire plus avant les quéqués, malgré la Jeunesse de Tintoret qui nous tendait les bras au Luxembourg, et plus tôt nous avait tentés : je me voyais mal me roulant à terre aux pieds d’un doge.
A Plieux ce matin l’ordre règne : le chien de Mme Le Coz aboie sans discontinuer, comme si nous n’étions jamais partis. »